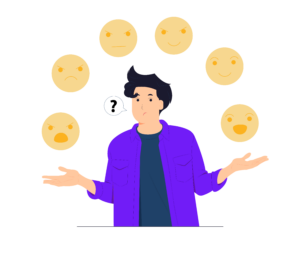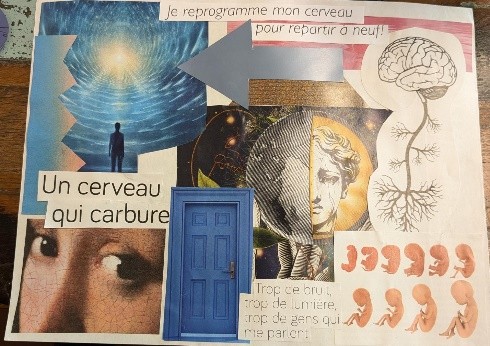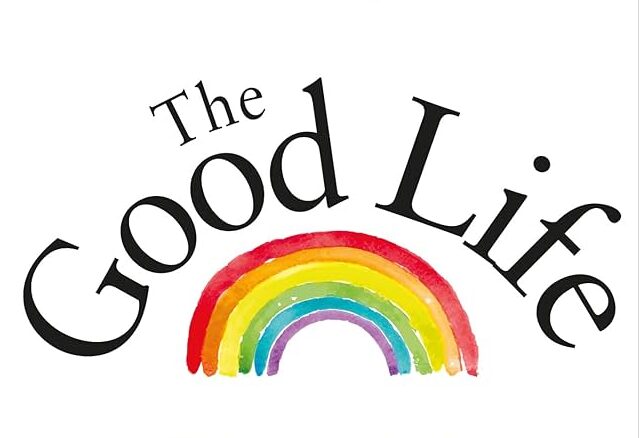En général, le stress est bien mal-aimé. Revisitons le stress pour voir qu’il n’est pas que mauvais! En effet, le stress est une réponse normale, et parfois même désirable, qui peut nous aider à naviguer certains défis de la vie. Comprendre les nuances du stress peut nous aider à le gérer plus efficacement.
Qu’est-ce que le stress?
À la base, le stress est une réaction de notre corps face à une menace. C’est grâce au stress que nous adoptons des comportements qui peuvent être utiles à notre survie, notre performance et permettre de nous dépasser et de nous adapter. Par exemple, le stress ressenti avant une compétition de sport ou encore une présentation orale augmente notre énergie, notre attention et notre motivation. Ainsi, le stress peut contribuer à améliorer la performance. Bien que le stress à dose modérée puisse être bénéfique, il n’y a aucun doute que le stress prolongé, répétitif ou excessif est problématique. Dans ce cas, le stress peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et psychologique.
Qu’est-ce qui nous stress? Stresseurs absolus et relatifs
Il existe deux types de stresseurs : les stresseurs absolus et les stresseurs relatifs. Cependant, le corps ne fait aucune distinction entre ces types de stress : il réagit de la même manière aux stresseurs absolus et relatifs. Un stresseur absolu représente un danger réel et imminent pour notre vie. Les stresseurs absolus provoquent du stress chez tous les individus qui y font face. Se faire pourchasser par un ours agressif et affamé serait un exemple de stress absolu. En réalité, les stresseurs absolus sont plutôt rares de nos jours.
D’un autre côté, les stresseurs relatifs sont des situations qui ne menacent pas notre survie, et qui peuvent tout de même générer du stress. Par exemple, déménager, une dépense imprévue, les bouchons de circulation, parler devant des personnes … En fait, les stresseurs relatifs résultent de notre interprétation d’une situation : ils sont donc propres à chacun. Une personne peut percevoir une situation comme stressante, alors qu’une autre n’aura pas la même lecture de la situation. Tout est donc une question de perception.
Les ingrédients du stress : C.I.N.É
De nos jours, la plupart des stresseurs que nous vivons sont relatifs (notre vie n’est pas réellement menacée). Même si les stresseurs relatifs peuvent être interprétés différemment par chacun, il existe une recette commune du stress : C.I.N.É. Cette recette contient quatre ingrédients : un sentiment de Contrôle faible, l’Imprévisibilité, la Nouveauté et une menace à l’Égo. Il ne suffit que d’un ingrédient pour qu’une situation nous fasse ressentir du stress. Plus il y a d’ingrédients présents dans une situation, plus nous sommes susceptibles de ressentir du stress.
Redéfinir sa relation avec le stress
Comment nous voyons le stress peut également entraîner des répercussions. Avoir l’idée que le stress peut être un allié dans nos performances pourrait nous aider à mieux performer que lorsqu’on perçoit le stress comme étant uniquement néfaste. Il est donc important de se rappeler que vivre du stress est normal. Après tout, le cerveau est une machine à détecter des menaces, réelles ou perçues, pour nous sauver la vie. Développer une perception balancée du stress (il n’est pas que néfaste et il n’est pas que bon) pourrait donc nous aider à l’apprivoiser. Une autre façon d’apprivoiser son stress pourrait passer par l’écoute et la compréhension de notre stress.
Être à l’écoute de son stress
Lorsqu’on remarque des signes de stress, on peut prendre un moment pour se demander : quelle est la situation à l’origine de mon stress? Ensuite, on peut prendre le temps de déconstruire la situation stressante avec les ingrédients C.I.N.É. Ceci nous aidera à mieux comprendre à quelle situation/ingrédient nous sommes plus sensibles.
Voici des exemples de questions à se poser :
Contrôle faible : Est-ce que j’ai l’impression d’avoir peu ou pas de contrôle sur la situation ?
Imprévisibilité : Est-ce qu’il s’est produit quelque chose d’inattendu? Est-ce que je sens que la suite des choses est incertaine/inconnue?
Nouveauté : Est-ce que je suis dans une situation nouvelle, dans laquelle je n’ai jamais été?
Égo : Est-ce que je sens que mes capacités et mon égo sont en jeu ou remis en question?
D’ailleurs, si vous êtes intéressés à en apprendre plus sur quel ingrédient du stress vous affecte le plus, je vous invite à répondre à un questionnaire développé par le centre de recherche sur le stress humain : https://www.stresshumain.ca/le-stress/questionnaire-cine-2020/
En bref, le stress est une réponse naturelle et adaptative qui nous prépare à gérer une menace. La plupart des situations qui provoquent du stress sont propres à chacun, mais ils ont des ingrédients communs. Développer une perception plus nuancée du stress peut nous aider à apprivoiser le stress comme une ami plutôt qu’un ennemi.