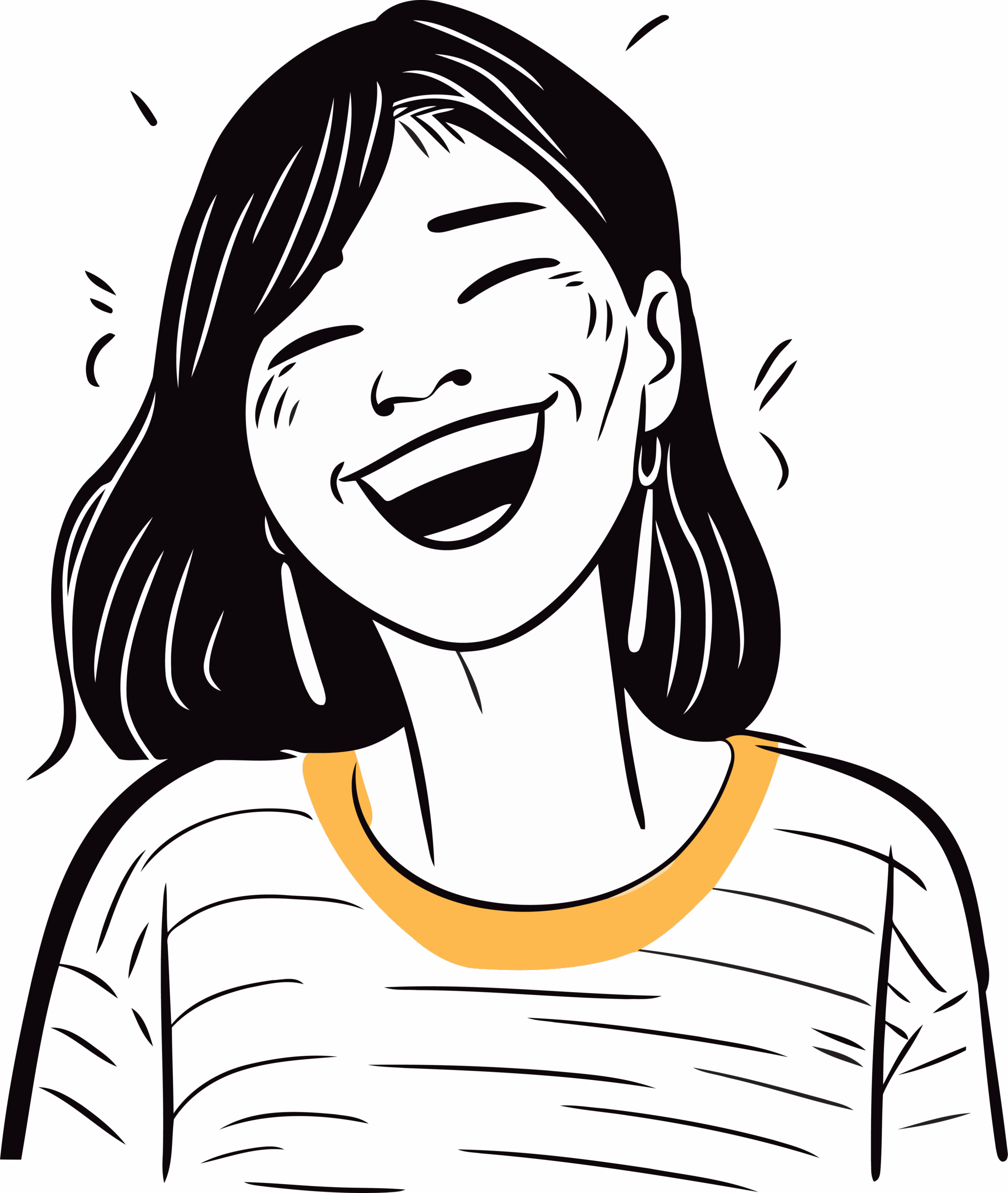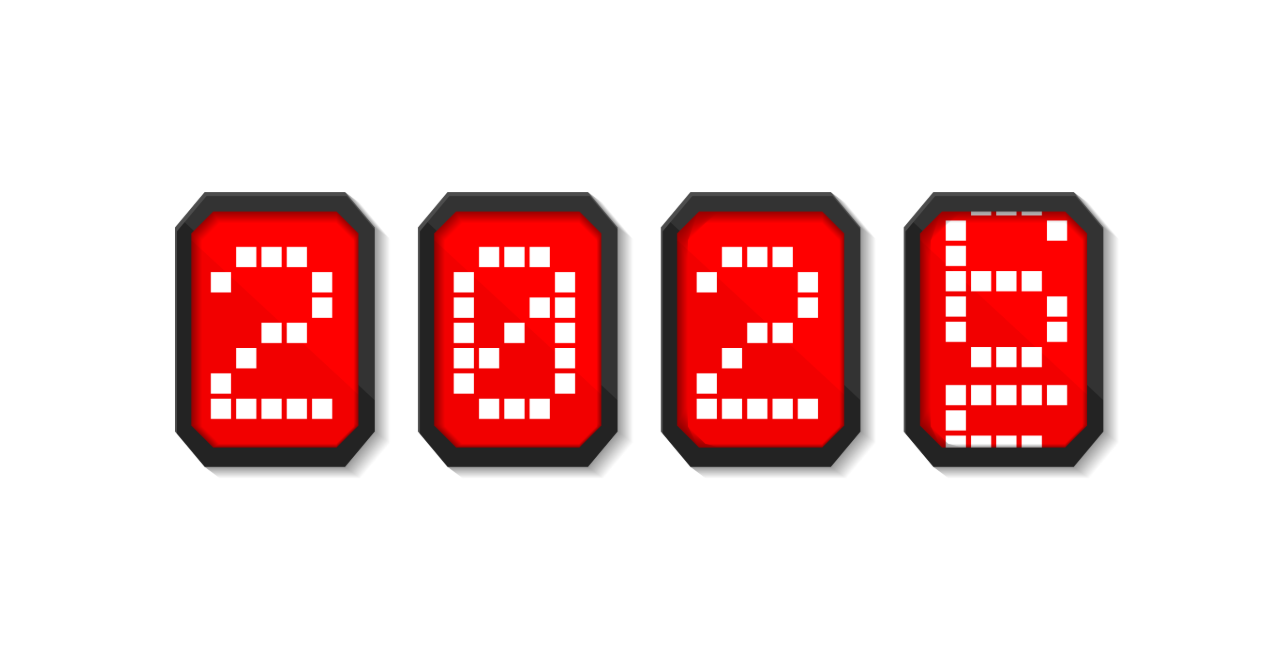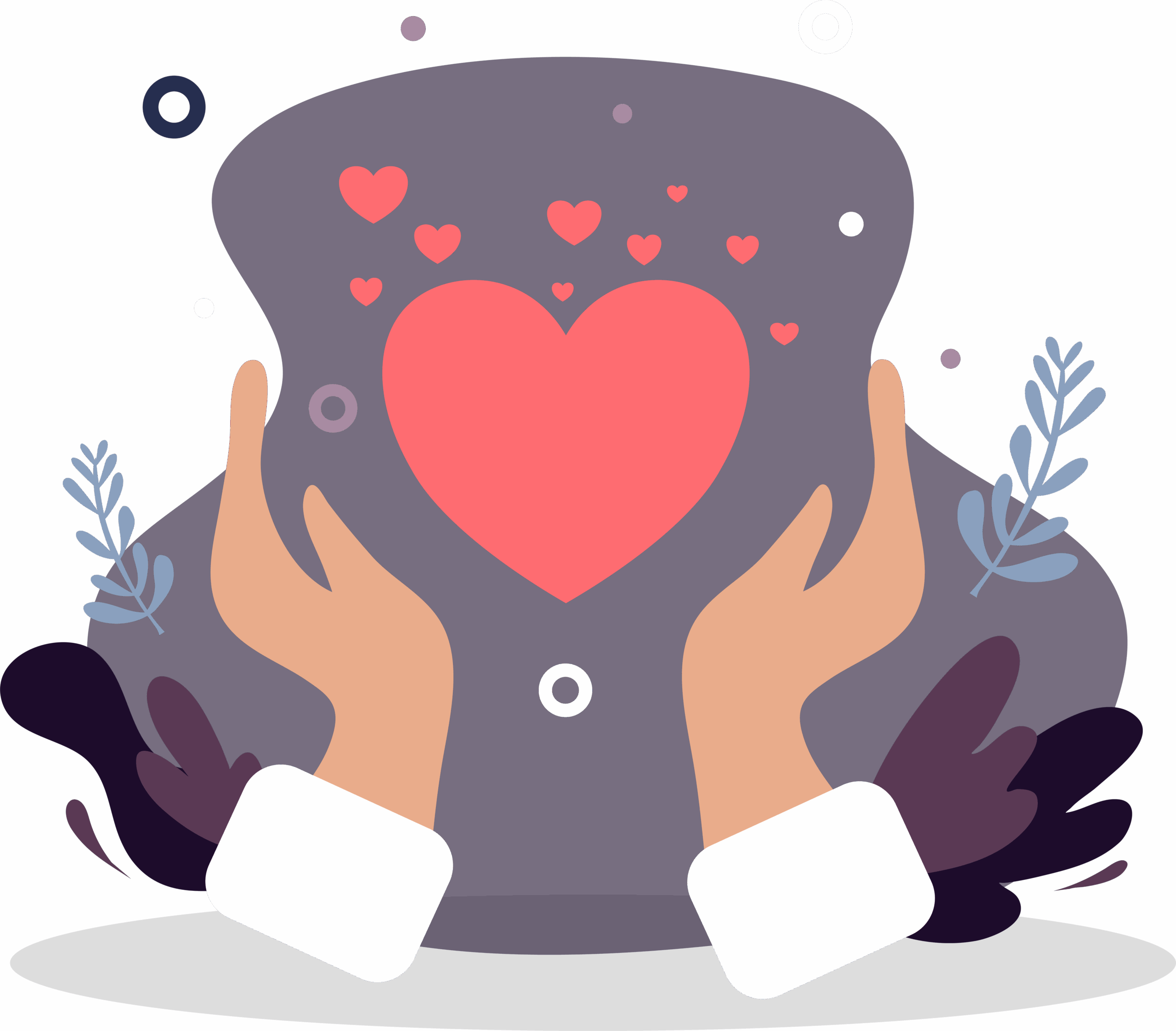Démystifier la profession d’intervenant.
Depuis le début de ma carrière comme intervenant, j’ai souvent constaté que certains usagers mentionnent qu’ils aimeraient travailler en relation d’aide. Inspirés par leur parcours et cheminement individuel, épris par un désir d’aider et dans le but de redonner, ces usagers ou usagères désirent s’investir dans l’intervention. J’ai pu remarquer que des usagers peuvent devenir de très bons intervenants. Il ne s’agit pas du tout d’une idée saugrenue. Cependant, il demeure que certaines capacités sont nécessaires afin de combler ce poste. En effet, certaines qualités demeurent inhérentes au poste. De plus, au niveau des tâches, le contact avec les autres et l’aspect de relation d’aide sont bien présents, mais il demeure que plusieurs autres tâches sont effectuées dans l’ombre et ne sont pas apparentes. C’est pourquoi nous aborderons le tout dans ce texte, dans le but de démystifier la profession d’intervenant.
Les qualités nécessaires!
Plusieurs qualités sont évidemment nécessaires afin de pouvoir travailler en relation d’aide. Ses qualités doivent transcender la profession et être présentes chez l’individu. Il est nécessaire que ce soit naturel d’agir ainsi. Sinon, la personne devra aller puiser trop loin afin de satisfaire aux exigences du poste. Cette carrière est très demandante, si en plus la personne doit agir à contresens des capacités de bases nécessaires, elle s’épuisera rapidement. Les qualités nécessaires les plus apparentes sont l’empathie, soit la capacité à se mettre à la place d’autrui et percevoir ce qu’il ressent. Cet aspect est tout de même fondamental pour oeuvrer en intervention. La capacité de facilement entrer en contact avec les gens et d’être en mesure de se connecter avec leur vécu et leur histoire demeure une facette primordiale de cette profession. Ceci est possible seulement grâce à une autre caractéristique importante, soit la capacité au non-jugement. En effet, on peut définir le non-jugement comme étant une attitude consistant à s’abstenir de porter des jugements de valeur sur autrui, leurs actions ou leurs paroles, en évitant de les approuver ou de les désapprouver. Si on pense à d’autres qualités importantes, l’une d’entre elles est l’écoute. En effet, nous avons souvent l’impression qu’il est important d’avoir de la répartie lorsque l’on travaille en intervention. C’est bien le cas, mais il est bien plus important d’avoir une bonne écoute afin de bien saisir et comprendre les propos de la personne que nous avons en face de nous. L’intervenant doit également être en mesure de laisser la place à la personne qu’il reçoit. En effet, l’intervenant doit pouvoir mettre la personne en valeur en lui laissant la place nécessaire afin qu’elle s’exprime et se confie. Conséquemment, l’importance de l’intervenant est de prendre une place secondaire dans l’intervention et permettre à l’autre de s’épanouir. Posséder une capacité d’introspection est également important.
Cette capacité est ce qui permettra à un intervenant de s’améliorer et de progresser, car c’est ce qui lui permet d’identifier ses limites et de les traverser. Comme on le dit si bien; en
intervention, nous sommes notre outil, il est important de l’aiguiser et l’affûter en se questionnant sur nos comportements et réactions. En terminant, l’intelligence émotionnelle est un aspect primordial de la relation d’aide. Elle se définit comme étant la capacité de percevoir et d’exprimer les émotions, de les comprendre et de les intégrer à la pensée en les utilisant avec justesse dans le raisonnement, ainsi que de réguler ses propres émotions et celles des autres. C’est pourquoi il s’agit d’une caractéristique importante à avoir.
Quelles sont les tâches d’un intervenant?
Maintenant que les caractéristiques d’un bon intervenant ont été identifiées, j’aimerais démystifier les tâches qui sont en lien avec l’intervention. Évidemment, effectuer des rencontres avec les usagers ou usagères constitue un aspect important du travail. Cependant, ces tâches ne sont pas les seules et plusieurs autres tâches s’effectuent dans l’ombre. Il y a beaucoup de tâches administratives à réaliser en tant qu’intervenant, telles que rédiger des notes, répondre aux questions de partenaires, répondre à tous ses courriels, s’assurer de transmettre les informations nécessaires à ses collègues, et plusieurs autres. Toutes ses tâches sont chronophages et absentes au premier regard. Ici, je parle aux usagers et usagères du CAFGRAF, ce sont les tâches que vous nous voyez faire lorsque nous sommes dans le bureau vitré et que nous sommes concentrés. Une autre tâche importante est associée à la représentation, soit d’aller présenter les services dans d’autres organismes afin d’en faire augmenter la popularité et ainsi en faire profiter à plus de gens.
Le milieu!
De plus, il y a un aspect important dans la conception du travail d’un intervenant, soit le milieu dans lequel il travaille. En effet, le réseau de la santé offre souvent une plus grande structure de par l’ensemble et la complexité des services. Cependant, dans le milieu communautaire, les tâches sont souvent plus flexibles et le milieu offre une plus grande malléabilité des
horaires et des tâches.
Voici les points que je désirais aborder avec vous afin de mieux vous faire connaître le rôle et les tâches d’un intervenant. En espérant que ceci a permis de démystifier la profession et ainsi vous en apprendre davantage sur les aléas de ce travail qui nous tient tellement à coeur.
Références :
1.https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17055232/attitude-de-non-jugement
2.https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26506945/intelligence-emotionnelle
L’art-thérapie en famille
Dans cet article, je vous propose de mieux comprendre comment l’art-thérapie familiale peut soutenir une famille. Je m’attarderai sur les bienfaits de se redécouvrir à travers un espace ludique et créatif pour réapprendre le plaisir d’être ensemble en famille.
Continue readingLes algorithmes et le bien-être psychologique : comprendre pour mieux naviguer
Nous passons une grande partie de notre quotidien en ligne. Une part importante de ce que nous voyons sur nos écrans est déterminée par des mécanismes invisibles, mais puissants : les algorithmes. Qu’est-ce qu’un algorithme exactement ? Et surtout, quelle est son influence sur notre bien-être psychologique ?
Qu’est-ce qu’un algorithme ?
Un algorithme est une série d’instructions ou de calculs destinés à résoudre un problème ou accomplir une tâche.[1] Dans le contexte numérique, il sert à trier et recommander du contenu en fonction de nos comportements en ligne.
Par exemple, lorsque nous consultons Google Maps, l’algorithme calcule l’itinéraire le plus rapide pour se rendre à destination. Sur Netflix, il suggère des films en fonction de ce que nous avons déjà regardé. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, il analyse le temps que nous passons devant une vidéo, ce que nous cliquons ou partageons, afin de créer un fil d’actualité personnalisé. En bref, chaque action en ligne, aussi petite soit-elle, alimente ce mécanisme qui anticipe nos préférences et nous propose du contenu jugé pertinent.
Quand l’algorithme affecte le bien-être
Le contenu proposé
Si ce fonctionnement paraît pratique, il n’est pas sans conséquence sur notre bien-être. Bien sûr, l’influence des algorithmes sur notre bien-être psychologique est complexe et nuancée : il peut y avoir des effets positifs, mais aussi entraîner des dérives.
Un rapport par Amnesty International rapporte un phénomène particulier où une bulle algorithmique se développe à partir d’un petit geste. À partir d’un simple « j’aime » sur une vidéo évoquant la tristesse peut transformer complètement leur expérience en ligne. C’est ce qu’exprime Francis*, un étudiant de 18 ans interrogé par Amnesty International :
« Quand j’«aime» une vidéo triste qui me parle, tout à coup, toute ma page “Pour toi” est triste. Je me retrouve dans le «TikTok triste ». Ça affecte mon humeur. » – Francis*, 18 ans, étudiant aux Philippines. [2]
Ce témoignage illustre comment une simple interaction peut suffire à orienter tout un univers numérique vers un seul type de contenu, enfermant la personne dans une bulle émotionnelle qui influence directement son état d’esprit.
La dépendance et la perte de contrôle
Un autre aspect est la manière dont les algorithmes exploitent notre attention. Les plateformes numériques sont conçues pour capter et retenir notre attention pour prolonger notre temps d’écran, notamment en proposant constamment du contenu qui sont dans nos champs d’intérêt, mais aussi par des vidéos courtes et un déroulement infini, par exemple. Tout est pensé pour maximiser le temps passé en ligne, ce qui en revanche peut entraîner une certaine forme de dépendance et un sentiment de perdre le contrôle.
Les études montrent que les jeunes ressentent particulièrement cette emprise. Selon une enquête récente, plus de deux jeunes sur trois disent avoir du mal à réduire leur temps passé sur les réseaux sociaux, et plusieurs mentionnent que ces plateformes constituent une source constante de distraction.[3]
L’envers de la médaille : quand l’algorithme devient un allié
Cela dit, il serait simpliste de diaboliser les algorithmes. Leur influence n’est pas uniquement négative. Dans certains cas, ils peuvent devenir de précieux alliés. Par exemple, ils peuvent faciliter l’accès à des témoignages inspirants ou à des ressources en santé mentale. Ils peuvent également permettre de trouver du soutien auprès des communautés en ligne, et de sentir que l’on n’est pas seul. De plus, la démocratisation des discussions autour de la santé mentale, en grande partie amplifiée par ces plateformes, peut contribuer à réduire les tabous et à normaliser le fait de demander de l’aide.
Les études montrent que les jeunes ressentent particulièrementcette emprise. Selon une enquête récente, plus de deux jeunes sur trois disent avoir du mal à réduire leur temps passé sur les réseaux sociaux, et plusieurs mentionnent que ces plateformes constituent une source constante de distraction.[3]
L’envers de la médaille : quand l’algorithme devient un allié
Cela dit, il serait simpliste de diaboliser les algorithmes. Leur influence n’est pas uniquement négative. Dans certains cas, ils peuvent devenir de précieux alliés. Par exemple, ils peuvent faciliter l’accès à des témoignages inspirants ou à des ressources en santé mentale. Ils peuvent également permettre de trouver du soutien auprès des communautés en ligne, et de sentir que l’on n’est pas seul. De plus, la démocratisation des discussions autour de la santé mentale, en grande partie amplifiée par ces plateformes, peut contribuer à réduire les tabous et à normaliser le fait de demander de l’aide.
Reprendre du pouvoir sur son expérience en ligne
Face à ces réalités, comment naviguer dans cet univers numérique sans se laisser submerger ? Voici quelques pistes :
• Prendre conscience du rôle des algorithmes : Comprendre que ce que nous voyons en ligne est le résultat d’un tri, et non un reflet objectif du monde. Cette prise de conscience permet d’instaurer une certaine distance face au contenu.
• Limiter le temps d’écran : Utiliser les paramètres de temps d’utilisation sur son téléphone ou des applications de gestion peut aider à reprendre du contrôle.
• Prendre soin de soi hors ligne : Faire des activités qui nous apportent du bien, comme des activités physiques, sociales ou encore créatives.
• S’informer et en parler.
En somme, les algorithmes façonnent notre vie numérique. Ils influencent nos choix et nos émotions, parfois de manière subtile, d’autres fois de façon plus marquée. Leur influence sur notre bien-être mental n’est ni totalement positive ni entièrement négative : ils peuvent amplifier des sentiments désagréables et la dépendance, mais aussi offrir soutien et ressources. Plutôt que de les voir comme bons ou de mauvais, il est sans doute plus juste de les considérer comme des mécanismes puissants qui nécessitent d’être connus, compris et apprivoisés.
Apprendre à reconnaître leur influence, développer une attitude critique et prendre soin de soi, autant en ligne qu’hors ligne, sont des moyens concrets pour naviguer dans cet univers numérique sans perdre de vue l’essentiel : notre bien-être.
Références :
1. https://numeriqueenquestions.uqam.ca/algorithme/
2https://www.amnesty.fr/actualites/tiktok-un-modele-dangereux-pour-la-sante-mentale-des-jeunes-et-des-enfants
3.https://www.digitalbarometer.ch/fr/sant%C3%A9-mentale-et-monde-num%C3%A9rique
PAGE
L’humour en santé mentale : Rire de soi sans se moquer de l’autre
Le rire est un réflexe universel. Il traverse les cultures, désamorce les tensions et crée des ponts entre les gens. Parfois, même dans les moments les plus difficiles, il surgit comme une bouffée d’air. Lorsqu’on parle de santé mentale, le rire peut devenir un véritable outil pour apporter un peu de lumière là où tout semble sombre. Cela dit, tout ne se vaut pas. Oui, on peut rire mais pas au détriment de celles et ceux qui souffrent. Il y a une vraie différence entre rire avec et rire contre. Alors, comment trouver le bon ton ? Où s’arrête l’humour qui fait du bien, et où commence celui qui blesse ? C’est ce qu’on va essayer de démêler ici.
Quand l’humour nous relie
Parler de santé mentale, ce n’est jamais simple. Parfois, les mots manquent, et d’autres fois, on n’a tout simplement pas la force. Certains jours, tout expliquer ou mettre des mots sur ce qu’on ressent, c’est trop. C’est justement là que l’humour peut faire une entrée salutaire.
Il y a une vraie puissance dans le fait de pouvoir rire de soi. Pas pour se rabaisser, ni pour nier sa douleur, mais pour prendre du recul, désamorcer un moment difficile… ou juste ramener un peu de légèreté.
Prenons l’exemple de quelqu’un qui vit avec des TOC et plaisante en disant : « J’ai vérifié la porte huit fois ce soir, donc elle est définitivement bien fermée. » Ce n’est pas de l’auto-dérision pour faire rire les autres à ses dépens. C’est une manière de souffler. De faire avec ce qu’il vit. Et souvent, ce type de blague touche celles et ceux qui traversent les mêmes réalités. On se reconnaît, on se sent moins seul(e).
Beaucoup de personnes vivant avec l’anxiété, la dépression, les troubles bipolaires ou autres enjeux de santé mentale utilisent l’humour comme un réflexe de survie. C’est le cas de Maude Landry, comédienne québécoise, dans son spectacle Involution. Elle y aborde l’insomnie, la peur de vieillir, l’estime de soi, les spaghettis… et même les vampires. Des thèmes en apparence décousus, mais qui, dans sa logique bien à elle, finissent par se rejoindre. Le fil conducteur ? L’introspection, les troubles obsessionnels, la personnalité limite, l’angoisse. « Plusieurs de mes idées de numéros viennent de mes inquiétudes. Je transforme simplement mes angoisses en rigolade », explique-t-elle. C’est à la fois drôle et profondément humain.
L’humour qui soigne (vraiment)
Le rire ne fait pas disparaître la douleur, mais il l’allège, ne serait-ce qu’un instant. Et ce n’est pas qu’une impression. Une étude menée par Bennett et ses collègues en 2010 a montré que le rire peut réellement faire baisser les niveaux de cortisol (l’hormone du stress), renforcer le système immunitaire, et améliorer la qualité de vie chez les personnes en souffrance psychologique. Plus récemment, une revue publiée en 2022 par Shao et al. a démontré qu’après une thérapie par l’humour administrée à des personnes âgées, celles-ci montraient moins d’anxiété, moins de symptômes dépressifs, et un bien-être accru.
Pour ma part, le rire m’a aidé à traverser plusieurs moments difficiles. Il m’a offert un peu de répit quand mes émotions devenaient trop lourdes à porter. Cependant, avec le temps, j’ai aussi compris qu’un recours systématique à l’humour peut devenir une manière d’éviter les vraies conversations ou de cacher ce qu’on ressent vraiment. Dans mon cas, il m’est arrivé d’utiliser l’humour pour masquer un mal-être plus profond, sans toujours en avoir conscience.
Le rire peut donc être salvateur, mais il peut aussi devenir un masque, une manière de fuir ou de se protéger. Et parfois, il dérape.
Là où ça dérape : quand l’humour blesse
Évidemment, tout le monde n’a pas ce rapport apaisé au rire. Certaines blagues sur la santé mentale sont tout sauf bienveillantes.
On les entend encore trop souvent :
« Il est complètement schizo », « T’es bipolaire ou quoi ? », « Elle fait sa dépressive. »
Ces phrases, balancées à la légère, font plus de mal qu’on ne le croit.
Ce type d’humour réduit une personne à son trouble, banalise sa souffrance, et surtout, envoie le message que ces sujets ne méritent pas d’être pris au sérieux. C’est exactement ce qui empêche tant de gens de parler, de demander de l’aide, ou de se sentir légitimes dans ce qu’ils vivent.
Ce n’est pas une question de « ne plus rien pouvoir dire ». C’est une question d’empathie. Est-ce que cette blague construit ou est-ce qu’elle écrase ? Est-ce qu’elle crée du lien ou est-ce qu’elle isole ?
Souvent, le rire peut ouvrir une porte. Encore faut-il veiller à ce qu’elle ne claque pas au nez de quelqu’un.
L’humour, avec précaution
On dit que l’humour, c’est une question de timing. Cependant, quand il entre dans le champ de la santé mentale, c’est aussi une question de justesse. Un mot à côté, un rire mal placé, et ce qui aurait pu faire du bien peut vite devenir blessant. Pourtant, parfois, une blague bien sentie, un sourire complice, ça peut tout changer. Ça peut alléger, rapprocher et faire respirer. Ce texte n’est pas un mode d’emploi du rire « approprié », mais une exploration sincère d’un équilibre délicat entre légèreté, respect et humanité.
Un recours systématique à l’humour pour éviter les conversations sérieuses ou pour cacher ses émotions peut traduire un malaise profond. C’est parfois une façon d’éviter le contact émotionnel ou de masquer une dépression.
Trouver l’équilibre
La clé est de trouver l’équilibre entre information et divertissement. L’infodivertissement – facile à dire, difficile à réussir. On a beau expliquer que le rire est le meilleur remède et citer une pléthore d’études scientifiques, insuffler de l’humour tout en transmettant des renseignements de façon responsable à un public qui comprend souvent des personnes à risque n’est pas chose aisée.
Parler de santé mentale peut être amusant, mais ce sujet peut également être triste, épeurant et compliqué. Pour les promoteurs, les annonceurs et les publics, le juste équilibre est non seulement essentiel, il peut aussi changer des vies.
Références :
1. https://www.participaction.com/fr/blogue/sante-mentale/le-rire-est-le-meilleur-des-remedes/
2.https://commissionsantementale.ca/vecteur/cest-drole-la-sante-mentale/
3.https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2017-v42-n1-smq03101/1040263ar/
4.https://www.7jours.ca/2024/01/27/des-humoristes-souvrent-sur-leurs-problemes-de-sante-mentale-dans-ce-nouveau-documentaire
5.https://enclasse.telequebec.tv/contenu/Rire-et-sante-mentale/2854
6.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388122000202
7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1093/ecam/nep106
8.https://spec.qc.ca/nouvelles/maude-landry-transforme-ses-angoisses-en-rigolade#:~:text=%C2%AB%20Plusieurs%20de%20mes%20id%C3%A9es%20de,ce%20qui%20explique%20sa%20d%C3%A9marche.
Changer notre regard sur les résolutions
Le temps des fêtes approche à grand pas. À quoi ça ressemble pour vous ? Pour plusieurs c’est la tourtière, le ragoût de boulettes, les réunions de famille et amis, les cadeaux, et plus encore ! Une autre tradition que bien des Québécois suivent est de se donner une ou plusieurs résolutions pour l’année. Avec le nouvel an, c’est le moment de faire une rétrospection sur l’année qui finit et de se fixer des objectifs de mieux-être pour la suivante. Malgré tout, la majorité des résolutions sont abandonnées quelques mois après les avoir commencées.
Selon une étude faite en 2011, près de 78 % des Canadiens n’accomplissent pas leurs résolutions. Qu’est-ce qui fait que c’est difficile de les tenir ? Plus important encore, comment faire pour maximiser nos chances d’accomplir nos résolutions ?
En réalité, à quoi ça sert ?
On se donne des résolutions pour se dire que cette année, ce sera différent et ce sera mieux que l’année dernière. C’est pourquoi les résolutions portent souvent sur des choses qu’on veut enlever : je vais arrêter de fumer, je ne serai plus autant sur mon téléphone, je vais arrêter de grignoter entre les repas, je vais cesser de procrastiner mes corvées, etc. Ces objectifs viennent souvent d’un sentiment de culpabilité ou de honte mais n’adressent pas l’impact sur vous ou votre entourage. Que cherchez-vous réellement à atteindre ? Pour éviter que votre résolution provienne d’un sentiment de honte ou de culpabilité, regardez en quoi ce changement affectera votre vie ou votre quotidien. Qu’est-ce qui sera différent ? Comment allez-vous être plus heureux ? Il est important d’envisager concrètement l’effet du changement pour rester motivé et de garder le cap malgré les difficultés qui pourront survenir en cours de route.
Clarifier l’objectif
Pour qu’une résolution ait plus de chance de tenir, il faut bien la comprendre. Se dire : “En 2026 je serai plus en santé” porte beaucoup à confusion. Est-ce par rapport à l’alimentation, les habitudes de vie, l’activité physique ou autre ? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais il existe une formule pour vous aider à clarifier votre objectif. L’acronyme S.M.A.R.T. permet de prendre une résolution et de la peaufiner pour qu’elle soit plus concrète.
Il faut que votre résolution soit :
• Spécifique
• Mesurable
• Approprié
• Réaliste
• Temporel
Avez ces paramètres, il est plus facile d’établir les étapes pour atteindre votre objectif et de savoir si vous allez dans le bon sens ou non. Cela vous permettra aussi d’avoir l’espace pour vous adapter s’il se trouve que l’objectif n’était pas réaliste ou si de nouveaux paramètres imprévus se sont rajoutés au courant de l’année.
Prendre conscience du travail accompli
La résolution est claire : je vais perdre 30 livres d’ici la fin de l’été. Je vais le faire en courant avec mon chien tous les jours pendant 30 minutes. Je serais plus heureux parce que je serais plus fier de mon apparence et je passerais de bons moments avec mon animal. Toutes les conditions sont présentes pour que ça fonctionne. Arrivé à la fin de l’été, j’ai seulement perdu 15 livres. Plusieurs émotions désagréables peuvent monter : la déception, la frustration, le désespoir, etc. Si au lieu de regarder le résultat, on regardait le travail accompli ? En réalité, nous n’avons pas de contrôle sur le résultat final, seulement sur l’effort que nous avons mis pour y arriver.
Ce n’est pas un échec de ne pas avoir atteint l’objectif. C’est une réussite d’avoir essayé de l’atteindre et d’avoir mis en place des moyens pour le faire. Même si le résultat n’était pas celui attendu, il y a une fierté à retirer des efforts que vous avez mis pour y arriver. Bien que vous n’ayez pas perdu le poids voulu, vous avez tout de même atteint votre but de passer du bon temps avec votre chien. Cela vous laissera une bonne impression et aurez davantage l’envie de réessayer éventuellement. Si vous associez l’expérience à un sentiment déplaisant, il sera plus difficile de se motiver à recommencer dans le futur.
Soyez fier de vous
On se donne des résolutions parce qu’on veut s’améliorer, s’accomplir, se surpasser. Ce n’est pas pour vivre un échec, de la culpabilité, de la honte ou de la colère envers soi-même. Regardez ce que vous voulez réellement pour le nouvel an et comment vous pouvez rendre la résolution agréable. Finalement, ne vous arrêtez pas au résultat, prenez conscience du travail accompli. Chaque petit progrès, même temporaire, est une victoire qui mérite d’être reconnue et célébrée. En gardant en tête l’impact concret sur votre quotidien, il sera plus facile de s’y tenir et surtout, d’apprécier l’effort que vous avez mis pour l’atteindre, peu importe si vous avez atteint votre résolution ou non.
Références :
https://www.ipsos.com/en-ca/canadians-quick-make-new-years-resolutions-slow-see-them-through
https://lifesportsgear.com/fr/blogs/news/comment-tenir-vos-resolutions-du-nouvel-an-en-2025?srsltid=AfmBOopxWfiqUpgPJV2RGwdS6K-j2BnTxWqYa_E1MOCMeXxMASrQrDJ4
PAGE
Intervention auprès des pères
Au cours de ma carrière comme intervenant, j’ai eu la chance d’intervenir longtemps auprès d’hommes et plus récemment auprès des pères. C’est une clientèle fascinante avec laquelle il est facile de travailler, mais qui peut être plus ardue à solliciter pour différentes raisons. En effet, les données démontrent que les pères sont moins présents dans les services que les mères. Il s’agit d’un constat qui est dommage, mais tout de même bien présent.
Qu’est-ce qui fait que les pères utilisent moins les services en relation d’aide ?
C’est une situation que j’ai constatée. Les hommes semblent être moins présents que les femmes dans les services en relation d’aide. Sans affirmer que ma constatation est d’une vérité
immuable, de ma modeste expérience, c’est ce que j’ai pu observer. Il peut y avoir des explications pour cette observation. Lorsque l’on prend le temps de réfléchir aux stéréotypes de la consultation, l’une des images que l’on se fait est d’être assis dans un bureau où la lumière est tamisée et où le résultat concret des rencontres demeure flou et abstrait. Ce modèle, bien que caricatural, contient tout de même des vérités et c’est peut-être ce qui rejoindrait moins les hommes et les pères. Étant en constante mouvance, un parent doit être volatil et disponible aux aléas des responsabilités familiales.
De plus, ma modeste expérience en intervention auprès des pères m’a indiqué que les pères auront moins tendance à demander de l’aide, car ils prioriseront le confort de leur famille en premier lieu, leur bien-être sera alors secondaire et même tertiaire. Ayant rencontré plusieurs pères qui étaient en détresse, ils cherchaient pour la plupart à alléger le fardeau des difficultés pour leur famille et peu d’entre eux pensaient à améliorer leur propre situation. En effet, certains d’entre eux ont la croyance que de demander de l’aide est synonyme de faiblesse, ce qui est bien entendu faux. Il est important de se ressourcer afin de prendre soin de nos proches.
Comment rejoindre les hommes/pères ?
Étant sous-représentés dans les services, plusieurs auteurs se sont penchés sur comment mieux rejoindre les pères. Plusieurs pistes d’actions ont été mises de l’avant. Une des façons de leur favoriser l’accès aux services a été d’adapter les heures d’ouverture en fonction de leur horaire.
En effet, offrir des services hors des heures de bureau, soit le soir ou la fin de semaine peut aider à ce qu’ils utilisent les services.
Tout ce qui favorise une approche informelle est habituellement gagnant. Ceci inclut d’être en mesure de leur offrir des services rapides et accessibles, soit directement lors de la demande d’aide. Leurs demandes d’aide peuvent être volatiles ou fugaces, et prendre la balle au bond est important afin de saisir l’opportunité lorsqu’elle se présente. Donc, avoir quelqu’un étant dédié à répondre à leur demande d’aide si jamais ils se présentent sans rendez-vous, peut être favorable. La mise en action est aussi un élément qui facilite l’accès aux services. En effet, de leur permettre de bouger avec leurs enfants est accrocheur pour eux. Planifier des activités sportives ou même des barbecues peut être un élément favorisant leur participation. De plus, c’est dans ces moments où il est facile d’entrer en contact avec eux.
Comment les maintenir dans les services
Une bonne méthode afin d’assurer leur rétention dans les services peut être de créer une alliance avec eux. La création et le maintien de cette alliance peuvent justement se faire de manière informelle, à travers des activités partagées en dehors du cadre formel du bureau, où l’objectif unique serait de parler des difficultés. Lorsque le contact est créé et qu’ils se sentent à l’aise, il arrive souvent que ce soit eux qui s’ouvrent et abordent des sujets difficiles. Il est facile d’avoir le préjugé que les hommes et les pères ne se confient pas et ne s’ouvrent pas sur leurs difficultés. C’est tout le contraire lorsqu’ils se sentent en confiance, ils démontrent une grande perméabilité à l’intervention et les discussions sont profondes, riches et intarissables. C’est à ce moment que l’on peut comprendre l’importance que revêt la paternité à leurs yeux. Donc, leur offrir ce lieu où ils peuvent être eux-mêmes sans avoir le poids des attentes invraisemblables de pères, où il leur est possible de briser les préjugés et d’avoir droit à l’imperfection, leur permet d’entrer en contact avec eux-mêmes et avec d’autres pères vivant des difficultés semblables.
En conclusion, les raisons expliquant la dichotomie de la représentation des mères et des pères dans les services sont aussi diversifiées que complexes. Cependant, le poids du passé demeure présent et une des principales explications est que les hommes ne veulent pas être un fardeau et maintiennent la perception que demander de l’aide est un signe de faiblesse. Ceci est bien entendu une fausse croyance et, au contraire, il faut beaucoup de courage pour demander de l’aide !
Références :
https://isaiahcounselingandwellness.com/mens-mental-health-why-is-it-hard-for-mento-ask-for-help/#:~:text=One%20of%20the%20greatest%20reasons,to%20help%20than%20you%20realize
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.rvpaternite.org/
wp-content/uploads/2023/02/SQP2022_Rapport_250822.pdf
www.rvpaternite.org/wp-content/uploads/2019/01/principespourrejoindrelesperes.pdf
S’aimer, même quand c’est difficile
Il y a des jours où rien ne va, et pourtant, on continue comme si de rien n’était. Non pas parce que tout va bien, mais parce que montrer ses failles semble devenir un luxe.
Continue readingLes jeunes adultes : seuls ensembles
Lorsqu’on aborde la solitude des jeunes, il n’est pas rare d’entendre des phrases comme :
« C’est normal qu’ils se sentent seuls, ils passent leur vie sur leur téléphone! »
Ce raisonnement, bien que répandu, suggère que leur solitude résulte principalement d’un choix personnel, d’un manque d’efforts et de volonté pour créer de « vrais » liens. Pourtant, cette lecture, intuitive en apparence, tend à simplifier un phénomène bien plus complexe.
Et si l’on prenait un peu de recul en examinant la solitude comme un reflet d’enjeux plus larges, plutôt qu’un simple problème individuel?
Se sentir seul
La solitude est un sentiment subjectif : « je me sens seul ». Elle se distingue de l’isolement social, qui est l’absence observable et objective de liens sociaux (par exemple : le nombre de relations ou la fréquence des contacts sociaux). Ainsi, une personne peut être entourée, mais tout de même se sentir seule
Il y a aussi une distinction entre la solitude choisie, qui est une brève expérience désirée, bénéfique et ressourçante où une personne se retire volontairement; et la solitude subie qui est une expérience non-volontaire. C’est cette solitude plus souffrante que nous abordons aujourd’hui.
Un enjeu de santé publique
La solitude n’est pas seulement pesante à vivre. Elle entraîne des répercussions sérieuses sur la santé physique et mentale. En effet, elle augmente le risque de dépression, d’anxiété, de maladies cardiaques, et même de mortalité. Les chercheurs estiment que la solitude chronique entraînerait des conséquences aussi importantes sur la santé que de fumer 15 cigarettes par jour.
Face à cet enjeu, le Royaume-Uni a créé un ministère de la Solitude en 2018, suivi par le Japon en 2021. Ces décisions politiques reconnaissent que la solitude n’est pas qu’une affaire du domaine privée : elle prend racine dans le tissu social.
Un phénomène en progression chez les jeunes adultes
Les chercheurs ont constaté que le sentiment de solitude chez les jeunes adultes est en constante augmentation depuis 40 ans. Au Canada, plus d’un jeune adulte sur 10 affirme se sentir toujours ou souvent seuls. C’est d’ailleurs chez les 25-34 ans qu’on observe le plus haut taux de solitude.
Ces statistiques nous invitent à élargir notre regard : la solitude chez les jeunes adultes n’est pas une exception, mais une expérience largement partagée.
Un sentiment qui isole… et culpabilise
Beaucoup de jeunes croient que s’ils se sentent seuls, c’est qu’ils ne font pas assez d’efforts pour socialiser, ou encore qu’ils manquent de compétences sociales. Ces critiques internes sont d’autant plus renforcées avec le discours ambiant culpabilisant, du genre :
« S’ils lâchaient leur téléphone, ils créeraient des liens plus authentiques. »
Or, cette vision peut alimenter le sentiment de ne pas être adéquat, et peut générer de la honte, ce qui en retour, accentue encore plus la solitude.
Alors que des facteurs individuels jouent un rôle, les facteurs sociaux et structurels doivent être considérés, afin d’éviter de surindividualiser un mal collectif.
Pourquoi tant de jeunes se sentent seuls?
La solitude des jeunes est multifactorielle. Plusieurs dynamiques personnelles, sociales et culturelles peuvent y contribuer, dont :
• Une perception pessimiste de la bienveillance des autres : Le rapport mondial sur le bonheur soulève que les jeunes perçoivent souvent les autres comme moins bienveillants qu’ils ne le sont en réalité. Les jeunes seraient donc moins enclins à prendre des risques sociaux, nécessaires pour tisser des liens, peur d’être jugé ou rejeté. Il faut donc se questionner : mais qu’est-ce qui alimente cette méfiance sociale?
• Une pression sociale et comparaison constante: Nous sommes dans une ère où l’homme n’a jamais été autant exposé à la vie et aux réussites des autres via les réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux offrent une vitrine sur la vie des autres, souvent embellie et fragmentaire. Cette exposition quotidienne à des images de succès, de bonheur ou de perfection peut amener une personne à sentir qu’elle n’arrive pas à répondre aux attentes implicites véhiculées, que ce soit en lien avec l’apparence, les accomplissements ou les relations. Ceci peut l’amener à sentir qu’un fossé se creuse entre elle et les autres, puisqu’elle perçoit un décalage entre sa vie et celle des autres.
• Une perte de repères et de sens : Certains peuvent avoir de la difficulté à donner du sens à leur avenir, à se projeter ou à trouver une place dans un monde qui évolue rapidement (climat, emploi, logement, …).
• Des barrières sociales : Les inégalités, la discrimination, le racisme et les stigmatisations renforcent le sentiment de solitude de certains jeunes.
La solitude, sous plusieurs visages
La solitude peut émerger d’un sentiment de se sentir « déconnecté » de notre entourage, de la société, de notre environnement, et de nous-même. Cette expérience de se sentir seul est vécue pour plusieurs comme avoir l’impression de ne pas compter, de ne pas avoir sa place, de ne pas être à sa place, de ne pas se sentir compris, de ne pas se sentir entendu, …
La solitude n’est pas une expérience uniforme. Elle peut prendre plusieurs visages, par exemple :
• Sur le plan relationnel: ne pas avoir de personnes de confiance à qui se confier sans jugement;
• Sur le plan existentiel: se sentir inutile, perdu, sans direction;
• Sur le plan social et politique : se sentir exclu ou incompris autour des enjeux sociaux et politiques (ex. préoccupations sur les enjeux climatiques)
Certains cumulent plusieurs formes de solitude. Une personne peut ainsi ressentir un vide dans ses relations, se sentir isolée dans ses idées ou ses valeurs, vivre une grande insécurité quant à son avenir, et sentir qu’elle n’a personne avec qui en parler. Ce cumul rend l’expérience encore plus lourde à porter.
Et maintenant ? Vers des solutions individuelles et collectives
Lorsqu’on voit la solitude comme un problème individuel, il est logique que les solutions proposées soient uniquement centrées sur l’individu : modifier ses comportements et ses pensées, sortir de sa zone de confort, oser aller vers les autres. Ces conseils peuvent être utiles, mais ne suffisent pas.
Si la solitude est aussi enracinée dans nos environnements sociaux, alors les solutions doivent être à la fois individuelles et collectives. Cela ne veut pas dire d’ignorer les approches individuelles, mais plutôt d’élargir les solutions pour agir efficacement et de façon durable dans le temps.
Quelques pistes d’action collectives:
• Promouvoir une culture de l’écoute, la bienveillance, l’ouverture et le respect des différences, tant dans les familles que les institutions;
• Investir dans des espaces communautaires accessibles, accueillants et sécurisants où les jeunes peuvent se rassembler, partager et créer des liens;
• Valoriser les projets portés par les jeunes;
• Soutenir les initiatives qui favorisent les liens entre voisins, collègues ou citoyens, dans une perspective d’inclusion, de solidarité et de reconnaissance mutuelle.
La solitude des jeunes ne relève pas simplement d’un manque de volonté individuelle ou d’habiletés sociales, comme on le dépeint trop souvent. C’est un phénomène complexe, qui s’enracine plus profondément dans nos dynamiques sociales.
Briser la solitude c’est l’affaire de tous : des individus, des pairs, des familles, des milieux communautaires et des institutions. Notre capacité collective à recréer et valoriser les espaces de liens, de reconnaissance et d’écoute pourrait contribuer à soulager ce « mal du siècle ».
Références
1 Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social
isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on psychological
science, 10(2), 227-237.
2 Buecker, S., Mund, M., Chwastek, S., Sostmann, M., & Luhmann, M. (2021). Is loneliness in
emerging adults increasing over time? A preregistered cross-temporal meta-analysis and
systematic review. Psychological Bulletin, 147(8), 787.
3 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2022007-fra.htm
4 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2022007-fra.htm
5 Pei, R., & Zaki, J. Connecting with others. World Happiness Report 2025, 123. (p. 153)
6 Fardghassemi, S., & Joffe, H. (2022). The causes of loneliness: The perspective of young
adults in London’s most deprived areas. Plos one, 17(4), e0264638.
7 McKenna-Plumley, P. E., Turner, R. N., Yang, K., & Groarke, J. M. (2023). Experiences of loneliness
across the lifespan: A systematic review and thematic synthesis of qualitative studies. International journal of qualitative studies on health and well-being, 18(1), 2223868.
8 Van de Velde, C. (2025). Sociology of loneliness: An introduction. Acta Sociologica,
00016993251330960
Mes craintes par rapport au déménagement
Lorsque vous lirez ce texte, le déménagement du CAFGRAF dans les locaux de l’ALPABEM sera imminent. Les travaux sont terminés, le sous-sol est complètement transformé et le deuxième étage est construit et peinturé. Le plan de déménagement a été réfléchi, peaufiné, communiqué, et est probablement déjà en marche pour faciliter le plus possible l’étape finale de la mutualisation. Deux organismes, un toit commun, une mission commune : améliorer la qualité de vie des Lavallois souffrant d’un trouble de santé mentale ainsi qu’à celle de leur famille. Cependant, au moment où j’écris ce texte (avril), beaucoup de questions sont encore sans réponses et ça m’inquiète.
Lorsqu’on parle de stress, tout le monde sait ce que c’est, mais les causes sont souvent méconnues. On peut regrouper les causes du stress en 4 grandes catégories qui forment l’acronyme C.I.N.É. :
• Contrôle
• Imprévisibilité
• Nouveauté
• Égo menacé
Tout le monde a une réaction différente au stress et va réagir plus ou moins à chacune des catégories. Une personne peut être très tolérante à la nouveauté par exemple mais très affectée lorsque son égo est menacé, ou vice-versa. À chaque fois que l’on vit un stress, une ou plusieurs catégories sont impliquées. Pour moi, ce déménagement en déclenche 3 : le Contrôle, l’Imprévisibilité et la Nouveauté.
Pourquoi ça m’inquiète
Une échelle d’évaluation de stress a été développée par les chercheurs Holmes et Rahe qui évalue l’impact de plusieurs évènements stressants qu’une personne peut vivre. Cette échelle établit une cote à chaque élément, et plus le chiffre est grand, plus l’impact est grand et le risque d’avoir des problèmes de santé graves reliés au stress dans les deux prochaines années augmente. Plusieurs évènements s’y retrouvent, allant d’une infraction mineure à la loi jusqu’au décès de votre conjoint(e), mais ce qui m’intéresse aujourd’hui sont le déménagement ainsi que des changements majeurs au niveau professionnel. Ils constituent certains des facteurs les plus stressants qu’une personne peut vivre. De plus, ce déménagement vient ajouter plusieurs incertitudes par rapport à la forme que le CAFGRAF aura. Ces facteurs font en sorte que le stress du déménagement prend encore plus d’ampleur pour moi.
Le CAFGRAF auquel je me suis attaché depuis les 2 dernières années se transformera d’une manière ou d’une autre. Je serais naïf de penser que tout sera comme avant. Il y a tellement de variables en jeu et de facteurs à considérer, que je ne peux savoir avec précision ce qui va arriver. En essayant de prévoir l’inconnu, il est facile de se créer des scénarios catastrophiques. Et si les usagers ne suivent pas ? Et si les services ne répondent pas à la demande ? Et si les locaux ne sont pas prêts à temps ? Et si les jeunes ne sont pas intéressés à venir ?
C’est à ce moment que l’anxiété peut apparaître. Laissé à moi-même, ces questions sans réponse continueraient à tourner dans ma tête sans cesse. J’ai un contrôle limité sur la situation : je ne peux pas forcer les usagers à venir au CAFGRAF, je ne peux pas faire avancer les travaux plus rapidement, je ne peux pas faciliter le déménagement tant que ça, etc.
Je fais de mon mieux pour ne pas transmettre cette inquiétude aux autres, autant à l’équipe qu’aux usagers, mais c’est difficile. Le stress a la fâcheuse tendance à être contagieux. Si je partage mes inquiétudes, cela pourrait vous affecter négativement, et vous pourriez en parler à quelqu’un d’autre qui l’affectera négativement et ça ne finira plus. C’est pour cela que je garde mes appréhensions pour moi, mais je ne peux pas rester ainsi sans rien faire, il faut que je trouve une solution pour me rassurer.
Comment je m’en sors
C’est bien beau d’analyser mon stress, il faut quand même que je compose avec. Mais qu’est-ce qui peut m’aider à naviguer dans l’incertitude, la nouveauté et le manque de contrôle ? Pour moi, c’est la confiance.
La confiance envers la direction, qui travaille sans relâche pour minimiser l’impact de ce grand changement tant attendu sur nos services. La confiance envers mon équipe, qui est présente pour me soutenir dans mes difficultés. Et surtout, la confiance envers vous, les usagers.
Durant les 30 dernières années, le CAFGRAF a subi de nombreuses transformations. De plusieurs points de services réduits à un seul, une équipe en constant changement, de nombreux déménagements, d’un horaire en soirée et fin de semaine à strictement la semaine et un seul soir, et j’en passe.
Malgré tous ces changements, vous êtes encore présents, à venir pour les activités, les ateliers et les centres de jour, à vous impliquer à différents niveaux dans notre organisme. Je suis confiant que vous allez donner une chance à ce nouveau chapitre qui s’écrit et même de contribuer à la rédaction de celui-ci.
De votre côté, comment pouvez-vous composer avec ce stress ? Je pense que la réponse est un peu la même : faites-nous confiance. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à venir nous voir, il nous fera plaisir de vous écouter. Soyez assuré que nous travaillerons sans relâche pour que le nouveau CAFGRAF soit à la hauteur de vos attentes.
Oui, ce sera différent, mais l’essence du CAFGRAF restera toujours la même. Nous continuerons à vous soutenir dans votre rétablissement et je suis certain que vous trouverez votre place dans ce nouveau CAFGRAF.
Références :
Holmes, T.H. et Robe, R.H. (1993). The social readjustment rating scale. Journal of psychosomatic Research, vol 11, 213-218
Lupien, S. (2010). Par amour du stress, Éditions au Carré, 274 pages.