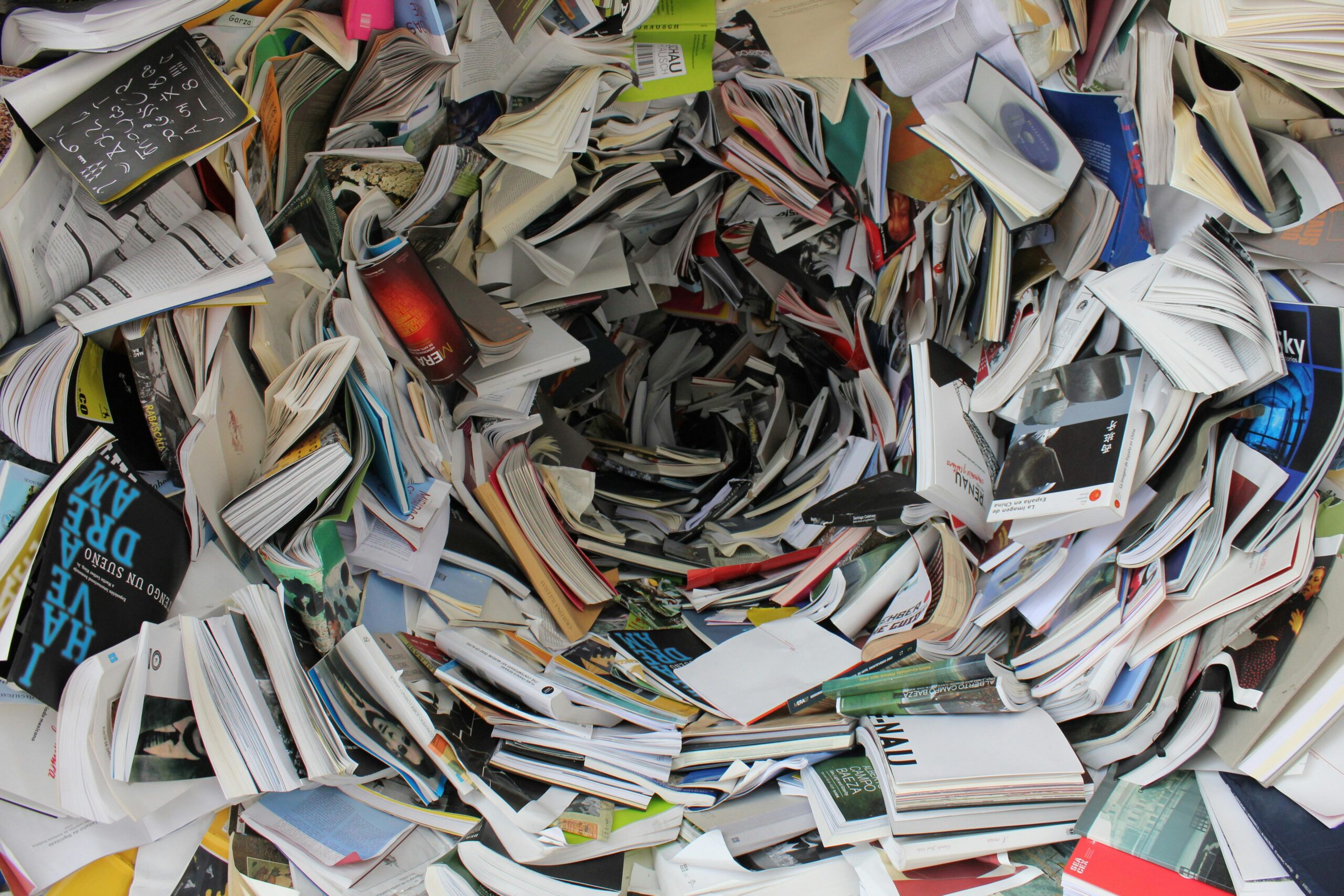L’ergothérapie est une profession permettant aux personnes de réaliser les occupations qu’elles considèrent comme importantes. L’ergothérapie est décrite comme étant « l’art et la science de l’habilitation de la personne à l’engagement dans la vie de tous les jours par l’occupation ; habiliter les personnes à effectuer les occupations qui favorisent leur bien-être ; habiliter les membres de la société, de telle sorte que celle-ci soit juste et inclusive afin que tous puissent s’engager, selon leur plein potentiel, dans les activités de la vie quotidienne».
Une occupation est l’ensemble d’activités et de tâches de la vie quotidienne auxquelles les individus et les différentes cultures donnent un nom, une structure, une valeur et une signification. L’occupation comprend tout ce qu’une personne fait pour prendre soin d’elle (soins personnels), se divertir (loisirs) et contribuer à l’édifice social et économique de la communauté ‘productivité). C’est l’expertise de l’ergothérapeute. (ACE, 2002).
Les modèles conceptuels en ergothérapie
Cette profession s’appuie sur des modèles conceptuels. Ces derniers sont des outils essentiels pour guider la démarche clinique. En effet, ils permettent d’organiser les connaissances des thérapeutes, d’analyser les difficultés des clients de manière structurée et d’identifier les priorités d’interventions, dans le but de favoriser leur rendement et leur engagement occupationnel. Dans cet article, le modèle canadien du rendement et de l’engagement occupationnel sera détaillé.
Le Modèle Canadien du rendement et de l’engagement occupationnel (MCREO)
Le Modèle canadien du rendement et de l’engagement occupationnel (MCREO) est utilisé par les ergothérapeutes oeuvrant au Québec et au Canada. C’est un modèle centré sur le client. Cela signifie que les interventions visent à répondre aux besoins spécifiques de chaque individu, en tenant compte de ses valeurs, de ses objectifs et de son contexte unique. L’évaluation se fait souvent en collaboration avec la personne elle-même, garantissant une participation active dans le processus de prise de décision.
La personne est représentée sous plusieurs dimensions : la dimension physique (fonctions sensori-motrices, prothèse de hanche, fractures) ; la dimension cognitive (fonctions cérébrales, la mémoire, l’attention) ; la dimension affective (les émotions comme la colère, la tristesse ou la joie et les sentiments) et la dimension spirituelle (croyances, valeurs, projets de vies). Cette vision globale aide à comprendre la personne dans toutes ses dimensions, ses fonctions, ses activités, ses besoins et ses habitudes de vie.
Puisque chaque individu vit dans un contexte environnemental qui lui est propre, la personne est représentée à l’intérieur de l’environnement. L’environnement est divisé en quatre catégories : l’environnement social (les amis ou la famille de la personne, un voisin gentil) ; l’environnement culturel (la culture québécoise et canadienne par exemple) ; l’environnement institutionnel (les lois, la politique, l’économie ; règles de vie en communauté, etc) et l’environnement physique (le logement de la personne : appartement, maison, château, la rue ; les ressources financières). L’environnement offre des possibilités occupationnelles aux individus.
À cet effet, les occupations sont conceptualisées comme faisant le pont entre l’environnement et l’individu, puisque celui-ci agit sur son environnement par le biais de ses occupations. Ce modèle propose trois finalités occupationnelles, soit les soins personnels (manger, boire, se déplacer, faire son épicerie et son ménage), la productivité (le travail, les études et le bénévolat) et les loisirs (randonner, lire, dessiner).
Le rendement occupationnel est défini comme le « résultat d’un rapport dynamique qui s’établit tout au long de la vie entre la personne, l’environnement et l’occupation. Le rendement occupationnel évoque la capacité d’une personne de choisir, d’organiser et de s’adonner à des occupations signifiantes qui lui procurent de la satisfaction. » Puis, l’engagement occupationnel, « capture la plus large des perspectives de l’occupation ». Ce terme réfère à tout ce qu’une personne fait pour s’impliquer, s’investir, pour participer et pour s’occuper. Ainsi, l’engagement occupationnel est plus que la simple réalisation d’une occupation.
Le modèle canadien du rendement et de l’engagement occupationnel (MCREO)
Avantages de l’utilisation du modèle en santé mentale
L’utilisation du MCREO est cliniquement efficace pour détecter les changements significatifs des vies des personnes qui présentent des problématiques de santé mentale. En effet, l’utilisation du modèle en santé mentale permet de prendre en compte la subjectivité, la spiritualité de la personne ainsi que l’aspect social.
En santé mentale le MCREO, nous permet de regarder la personne au-delà de son diagnostic (bipolaire, schizophrène, etc.). Nous allons explorer et prendre en considération la personne dans sa globalité avec ses valeurs (ce en quoi elle croit) et ses forces.
Références :
Christiansen, C., Baum, C. M., & Bass-Haugen, J. (2005). Occupational therapy: performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack.
Dunn, W. (2011b). Using frames of reference and practice models to guide practice. Dans Best practice occupational therapy for children and families in community settings. Danvers: Slack inc.
Morel-Bracq, M-C. (2017). Les modèles conceptuels en ergothérapie. Introduction aux concepts fondamentaux (2ème édition). De Boeck Supérieur : Lausanne, Suisse.
Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ). Qu’est-ce que l’ergothérapie? Repéré à https://www.oeq.org/m-informer/qu-est-ce-que-l-ergotherapie.html
Sames, K. M. (2010). Documenting Occupational Therapy Practice. Upper Saddle River: Pearson Education, 36-46
Townsend, E.A., & Polatajko, H.J. (2013). Habiliter à l’occupation: Faire avancer la perspective ergothérapique de la santé, du bien-être et de la justice par l’occupation (2e ed. version française Noémi Cantin). Ottawa, Ont : CAOT Publications ACE.