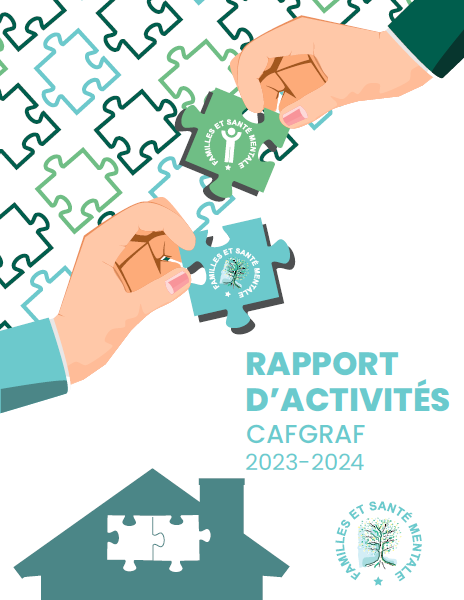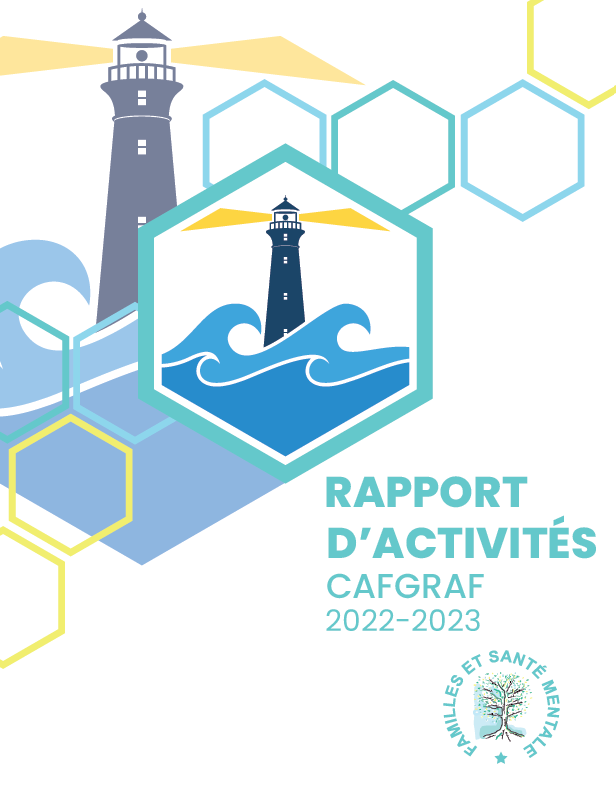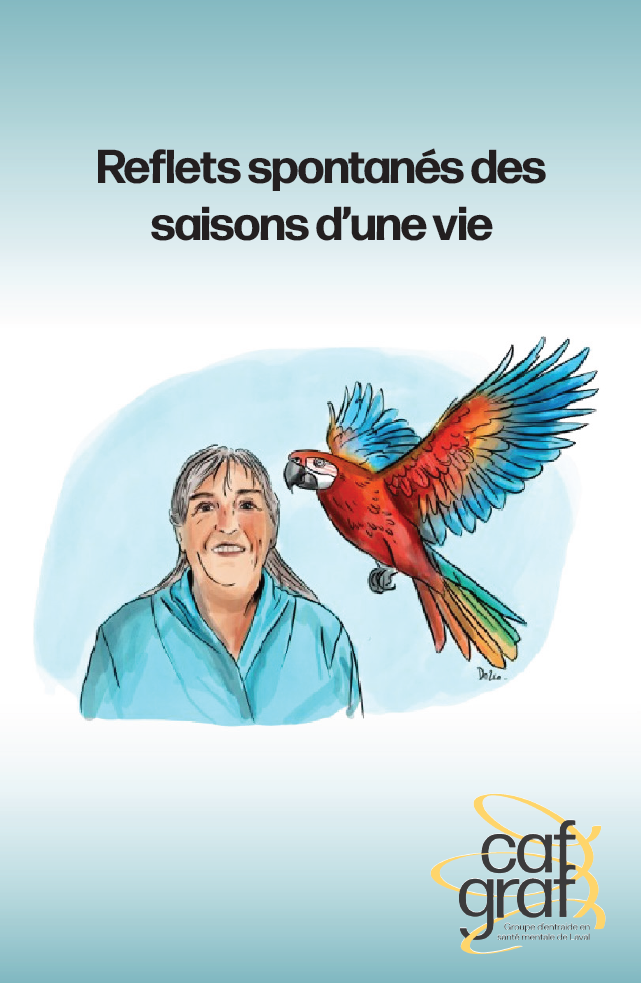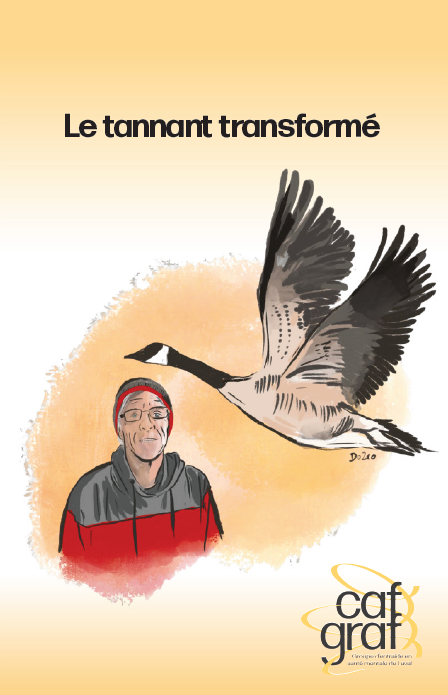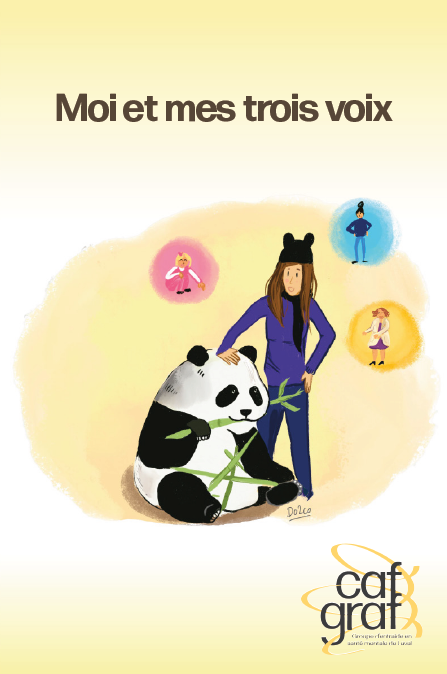Lorsqu’on parle de santé, on pense souvent à la santé physique. Pourtant, la santé mentale est tout aussi essentielle à notre bien-être global.
Il n’y a pas si longtemps, la santé mentale était simplement considérée comme l’absence de maladie mentale. Cependant, c’est une vision réductrice et simpliste. Avant d’aller plus loin, prenons le temps de faire la distinction entre deux notions : la présence (ou l’absence) d’un trouble mental ne détermine pas à elle seule l’état de santé mentale d’une personne. En effet, la santé mentale et la maladie mentale sont deux concepts distincts : une personne peut vivre avec un trouble de santé mentale et maintenir une bonne santé mentale en développant des stratégies d’adaptation efficaces et en recevant un soutien approprié. À l’inverse, une personne sans trouble de santé mentale peut vivre une grande détresse psychologique. Il est donc essentiel de promouvoir la santé mentale positive auprès de tous, indépendamment de la présence ou non d’un trouble de santé mentale.
Mais concrètement, qu’est-ce qu’une santé mentale positive et comment pouvons-nous l’encourager au quotidien ?
Comprendre la santé mentale positive
La santé mentale positive est caractérisée par un état de bien-être, qui englobe les différentes sphères de notre vie : émotionnelle, fonctionnelle, sociale et spirituelle. La santé mentale positive nous permet de profiter de la vie et de nous adapter aux défis de la vie avec la résilience nécessaire.
La santé mentale positive peut être comparée avec la santé physique : tout comme un sportif bien entraîné pourra récupérer plus facilement après un effort physique intense, une personne en bonne santé mentale pourra plus aisément mobiliser ses ressources pour s’adapter aux changements et aux épreuves. De la même façon que nous entretenons une bonne santé physique, nous pouvons cultiver une bonne santé mentale au quotidien.
Agir pour une santé mentale positive
Promouvoir la santé mentale positive vise à renforcer les facteurs qui soutiennent notre bien-être mental. En d’autres mots, on met l’accent sur le maintien et le développement des ressources internes et externes qui favorisent notre bien-être. Cette approche se distingue donc de la prévention, qui cherche à réduire les facteurs qui nuisent à la santé mentale. Plusieurs facteurs influencent la santé mentale. Bien que certains facteurs échappent à notre contrôle (ex. l’hérédité,
le contexte économique et social ou les évènements du passé), d’autres facteurs peuvent être renforcés à travers des actions concrètes. Cultiver une santé mentale positive, c’est agir à plusieurs niveaux : individuel, familial, communautaire et sociétal.
Sur le plan individuel
Adopter de saines habitudes de vie. Un sommeil de qualité, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée soutiennent la santé mentale, tout comme la santé physique.
Apprendre à gérer son stress et ses émotions. Apprendre à écouter et accueillir ses émotions sont des compétences clés pour gérer ses émotions. Intégrer des moments de détente et des exercices de respiration peuvent être des stratégies efficaces pour une meilleure gestion du stress.
Développer la connaissance de soi. Reconnaître ses forces, ses besoins et ses limites aide à s’adapter aux défis du quotidien et à renforcer l’estime de soi.
Apprendre à demander de l’aide. Rechercher du soutien auprès de son entourage ou de professionnels lorsqu’on en ressent le besoin est essentiel pour préserver son bien-être.
Sur le plan familial et social
La santé mentale positive se construit également à travers nos relations interpersonnelles. S’entourer positivement. Cultiver un réseau de soutien bienveillant avec des personnes qui nous comprennent et nous soutiennent est précieux dans les périodes plus difficiles. Favoriser un climat familial positif. Un environnement familial stable et sécuritaire, et une communication ouverte et bienveillante sont des éléments qui favorisent le bien-être mental de chacun. Accéder aux ressources de soutien. Il est essentiel d’avoir accès à des ressources de soutien en cas de besoin. Que ce soit un soutien obtenu à travers l’entourage ou par des ressources externes, comme le CAFGRAF.
Sur le plan communautaire
L’environnement dans lequel nous évoluons joue aussi un rôle majeur dans notre santé mentale. La communauté, que ce soit à l’école, au travail ou dans notre quartier, influence notre bien-être psychologique.Bien que nous n’ayons pas un contrôle total sur notre environnement, il est possible d’agir pour améliorer nos milieux de vie et ainsi créer des milieux favorables à la santé mentale. Voici quelques pistes d’action possibles :
Favoriser des environnements inclusifs. Un milieu inclusif, où la santé mentale est prise en compte et où chacun se sent accueilli et respecté, permet à la collectivité de s’épanouir. Ceci passe par la sensibilisation et l’éducation des milieux scolaire, de travail et de la communauté. Parler de santé mentale permet d’encourager un climat positif bienveillant, ainsi que de réduire la stigmatisation et d’améliorer le bien-être collectif.
S’engager socialement. De même, l’engagement social, comme s’impliquer dans des initiatives communautaires, participer à des projets collectifs ou améliorer les espaces
communs renforce la santé mentale positive individuelle et collective.
Sur le plan sociétal
Finalement, à une échelle encore plus large, les réalités sociétales influencent profondément la santé mentale. Les inégalités, la stigmatisation et la discrimination sont des freins à une bonne santé mentale. Par exemple, la peur du jugement peut empêcher certaines personnes de chercher l’aide dont elles ont besoin, aggravant ainsi leur détresse. Il est donc essentiel de promouvoir des initiatives qui favorisent une société plus équitable et inclusive pour que chacun puisse s’épanouir pleinement.
Conclusion
En bref, il est possible d’agir pour renforcer notre santé mentale positive, que ce soit sur le plan individuel, familial, social
ou communautaire. En agissant individuellement et collectivement, nous pouvons créer un environnement propice
au bien-être mental de chacun.
Références
https://casecultive.ca/la-sant%C3%A9-mentale-positive-cest-quoi